Un vendredi de janvier 1942
/image%2F0680259%2F20240420%2Fob_be03af_dessin-mere-allaitant-son-bebe.jpg)
Madeleine s’active dans leur petite chambre, pour que tout soit propre et joli afin d’accueillir son homme. Stanislas devrait rentrer pour le weekend. Nadja s’est endormie dans son berceau, quand Madeleine se rend compte qu’elle n’a plus de pain. Hésitante, elle se dit que le bébé dort, et qu’elle n’en a que pour quelques minutes, le temps de descendre, de courir à la boulangerie, et de revenir, la petite ne se rendra pas compte de son absence. Elle couvre Nadia d’un lainage supplémentaire, l’embrasse sur le front, et sort sans bruit. Laissant la clef sur la porte, afin que les voisins interviennent si la petite pleurait trop fort. Elle dévale les escaliers, et court dans la rue jusqu’à la boulangerie. Elle a oublié qu’il pourrait y avoir la queue, comme de plus en plus souvent. Dans la file, les gens discutent entre eux, échangeant sur le prix de toute chose, les tickets d’alimentation, la faim, les maladies, les enfants, la guerre, les attentats… Madeleine ne s’en mêle pas, elle est préoccupée, « si ma douce Nadiejda se réveille et qu’elle pleure, pourvu que la queue se résorbe suffisamment vite… ».
Enfin c’est son tour de prendre une part de pain noir contre ses bons de rationnement. Elle se presse pour remonter la rue d’un pas rapide, quand elle croise un voisin.
- Ah vous êtes là ! S’écrit-il, on a entendu la petite hurler alors on est monté voir, et on a vu les boches chez vous !
Stupéfaite, elle en laisse tomber son filet avec son pain. L’homme le ramasse et lui tend.
- Ça va aller ma p’tite dame ? Madeleine pense à toute allure, son bébé qui doit avoir été réveillé par ces brutes, et Staczek qui va arriver par le bus … que faire ? Elle demande au voisin s’il veut bien attendre son mari à la station de bus pour le prévenir de ne pas monter, mais l’homme refuse,
- Ah non non non ! Je ne veux pas avoir d’ennuis moi ! Je ne sais pas ce que vous avez à vous reprocher tous les deux, et je ne veux pas le savoir ! ça ne me regarde pas ! C’est déjà bien que je vous prévienne.
Et il s’en va. Madeleine a le ventre qui se tord d’angoisse. Elle se dit qu’« ils » ne feront rien à un bébé, du moins l’espère t’elle, qu’il n’y a rien à trouver chez elle, mais que Staczek ne doit surtout pas rentrer à la maison. C’est sûrement lui qu’ « ils » sont venus chercher. Elle se résout donc à l’attendre, les mains dans les poches de sa veste. Ils ont convenu de cela ensemble, si jamais il y avait une alerte, mettre les mains dans les poches, et faire comme s’ils ne se connaissaient pas, marcher dans la même direction à distance et dès que la voie est libre, passer la main droite dans les cheveux.
Elle attend, un bus s’arrête à l’arrêt, sans voir descendre Stanislas. Il ne lui a pas donné d’heure pour rentrer. Le temps passe et la boule d’angoisse se fait de plus en plus violente dans son ventre. L’heure du couvre-feu ne va pas tarder, elle a froid, mais tremble de peur. Enfin un autre bus approche, elle baisse la tête, de peur qu’on ne voie qu’elle attende quelqu’un, les mains enfoncées dans ses poches. Elle fait celle qui cherche quelque chose à terre. Staczek a remarqué les mains et descend du véhicule sans la regarder, il s’accroupi pour relacer sa chaussure. Madeleine comprend qu’il lui donne de l’avance, alors elle prend la direction opposée à la maison, passe sa main dans ses cheveux et entre dans une porte cochère quelques mètre plus loin. Quelques minutes s’écoulent et il entre à son tour. Elle se jette dans ses bras,
- Les boches sont à la maison, murmure-t-elle.
- Je sais comment aller, ne t’inquiète pas moj scarbie. Je vois toi chez Mich’ euh Marcel demain, trébuche-t-il sur le nouveau prénom de son ami, surtout, donne beaucoup baiser de son papa à moje kochanie[1] Nadja.
Il l’embrasse, lui saisit le visage dans ces longues et larges mains râpeuses, la dévisage avec une grande douceur, l’embrasse encore, en silence et se sauve dans la nuit qui commence à tomber. Elle sort quelques minutes plus tard, émue par la tendresse de son homme, puis cours jusqu’à leur chambre. Elle entend sa fille hurler d’en bas, son cœur se sert de plus belle. « En tout cas elle est vivante et toujours là ! » pense-t-elle. Elle arrive enfin essoufflée, un allemand tient le bébé dans les bras, il essaye de la distraire mais l’enfant n’est pas coopérative, elle a faim et aucune berceuse, même en allemand, ne peut la calmer. Madeleine se précipite sur celui-ci, qui fronce les sourcils, et dit
- En voilà une mère qui laisse son enfant seul comme ça ! Où étiez-vous quand votre bébé pleurait ?
- Avec le froid qu’il fait dehors, une bonne mère ne sort pas son bébé ! Et si j’ai été longue c’est qu’il faut faire la queue pour obtenir un pauvre morceau de pain ! Répond-elle avec colère, leur montrant son filet encore à son poignet.
- Rendez-moi mon bébé ! ajoute-t-elle en arrachant son enfant des bras maladroit de l’allemand qui tentait de bercer la petite, je ne pense pas que vous soyez qualifié pour la nourrir vous-même ! Elle replace le tabouret contre le mur et cherche à s’installer pour allaiter son bébé.
Ils ont retourné toute la chambre, le lit est défait et la vaisselle, les vêtements, même les carottes qui étaient conservées dans une boite pleine de sable aussi, tout est sans-dessus dessous. Le berceau a également été fouillé, retourné. C’est alors qu’elle surprend le regard vicieux d’un des hommes, sur sa poitrine rebondie. Furieuse elle se voile dans son écharpe de laine en leur tournant le dos. Ils l’interrogent néanmoins.
- Où est votre mari Monsieur OBODA Stanilaw[2]?
- Il est en Allemagne, je crois, il est prisonnier, improvise-t-elle.
- Vous croyez ? Pourquoi croyez-vous ? Où ça en Allemagne ?
- Je ne sais pas
- Vous ne savez pas quoi madame ? S’il est prisonnier ? Ou bien où il se trouve ?
- Je ne sais pas où il est. Elle à la tête penchée sur son bébé, elle sent le regard inquisiteur de l’homme qui l’interroge et ne veux pas lui montrer qu’elle improvise ses réponses. Il faut qu’elle ait l’air sûre d’elle, mais à l’intérieur elle tremble de peur.
- Vous savez, madame, nous sommes des gens organisés et civilisés, et même nos prisonniers ont le droit d’écrire à leur épouse ! dit l’officier avec un certain mépris condescendant.
- Je ne sais pas où il est, répète Madeleine. Plus elle sera évasive pense-t-elle et plus elle laisse de temps à Staczek pour se cacher.
- Je suis sûre que vous savez qu’il n’a jamais été prisonnier madame, nous tenons des listes exactes de nos prisonniers, et je n’ai pas de OBODA Stanislaw dans mes listes. J’ai vérifié. Un instant elle panique, et improvise :
- Si vous voulez tout savoir, il m’a quitté, dit-elle en colère.
- Quel vilain homme ! Ce n’est pas correct de laisser sa femme et son enfant !
- Je ne sais pas où il est répète-t-elle d’un ton lasse, laissant perler des larmes aux coins de ses yeux, la pression, la peur, elle ne sait, mais ça fait son effet, l’homme semble s’adoucir. Elle répète : Il m’a quitté, vous croyez que ce n’est pas déjà assez dur pour moi ?
- Très bien madame, de toute les façons, nous n’avons rien trouvé ici, donc nous allons nous retirer. Si vous avez des nouvelles de votre mari, je voudrais être informé. Pouvons-nous compter sur vous ? demande l’officier d’un ton métallique et froid.
- Ça m’étonnerait que je le revoie un jour, prédit-elle, toute à son jeu de rôle, et même s’il revenait, vous croyez que je le reprendrai ? et d’abord qu’est-ce que vous lui voulez ?
- Il vaudrait mieux pour vous que vous nous informiez de son retour s’il revient, conclu l’homme au regard de glace. Le reste ne vous regarde pas. Aurevoir madame. Et ils s’en vont, laissant derrière eux le chao dans la chambre et dans le cœur de Madeleine.
Ils ont eu chaud.
commenter cet article …




/image%2F0680259%2F20240412%2Fob_252665_numerisation0291.jpg)
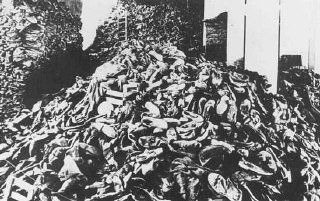





 c’est anecdotique et tragique à la
fois.
c’est anecdotique et tragique à la
fois.

